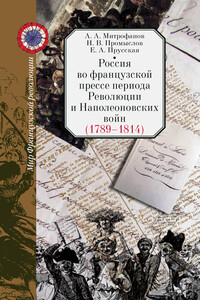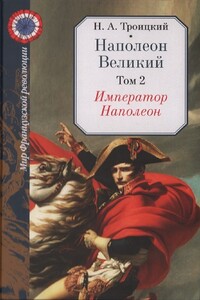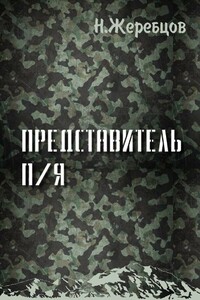Историки Французской революции | страница 74
Pour conclure je souhaiterais attirer l’attention sur l’historiographie post-soviétique. Aprns les changements positifs survenus dans l’ancienne URSS et aprns son éclatement, quelques auteurs russes, se référant à la conduite de leurs prédécesseurs des années vingt-trente ou en invoquant leurs discours contre les historiens non marxistes (notamment contre Tarlé) et soulignant leur conception de la dictature des Jacobins (qui glorifiaient Robespierre et approuvaient sans réserve tous les excns de la Révolution française) ont évoqué avec ironie de leur destin tragique lors de la terreur stalinienne[480]. Il me semble qu’ils n’ont probablement pas pris en considération qu’il s’agissait de la mentalité collective d’une génération entinre, au dessus de laquelle s’est dressé progressivement le glaive stalinien.
Quant au silence de mes prédécesseurs, il faut aussi prendre en considération une circonstance importante. Dans les années soixante-quatrte-vingt, la situation en URSS n’était pas favorable à la discussion des positions implacables contre Mathiez dans le cadre des réalités soviétiques des années vingt-trente. Comme à l’époque de la «stagnation», nous nous trouvions toujours sous la domination de l’idéologie communiste, de ce fait les observations critiques de Mathiez conservaient entinrement leur actualité d’une certaine manière. Une seule fois, la critique de Mathiez sur l’atmosphnre politique en URSS dans les années vingt-trente fut mentionnée. Certes on l’a fait, comme dans le passé, avec un ton trns particulier. Dans la biographie de Loukine, Ilya Galkine, son disciple, en s’abstenant de discuter les causes de cette polémique, a, par contre, de avancé de facto des accusations politiques infondées contre Mathiez, en soulignant qu’il n’avait pas donné une appréciation politique équitable à l’activité du gouvernement soviétique, ce qui a amené la rupture de ses relations avec Loukine[481]. N’oublions pas qu’en revanche, le regretté Vladimir Dounaïevski n’a fait allusion qu’à la rupture des relations de Mathiez avec ses collègues soviétiques, qui est demeurée, comme il l’a affirmé, «incertaine jujusqu’à la mort de l’historien français»[482]. Mais à cette époque, il ne pouvait certainement pas entrer dans les positions objectives.
C’est à l’époque post-gorbatchévienne qu’on a pu entreprendre les premières tentatives pour élucider cette polémique. Dans les années quatre-vingt-dix, Dounaïevski devint l’initiateur de la publication en russe de quelques documents qui jetaient une lumière sur cette discussion: il a par exemple réuni les deux lettres inédites de Friedland à Mathiez et de ce dernier à son opposant, datées de 1930, qu’il avait tirées des Archives de l’Académie des Sciences de la Russie, ainsi que