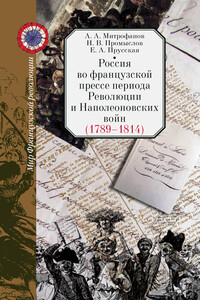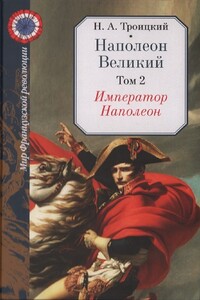Историки Французской революции | страница 67
Mathiez suivait attentivement le développement des événements politiques en Russie soviétique et la formation des mécanismes du pouvoir autoritaire stalinien dans les années vingt, accompagnée de l’extrême politisation et idéologisation de la science historique soviétique, ce qui n’a certainement pas échappé à son attention. / tant trns mécontent de pareilles transformations en URSS, les moindres germes de dé mocratie ayant disparu, Mathiez quitta en 1922 les rangs du Parti Communiste Français, et a rompit ses relations avec la Troisième Internationale[426]. Comme l’ont remarqué Yannick Bosc et Florence Gauthier, «Albert Mathiez n’a jamais accepté le principe d’une dictature, qu’elle soit exercée par un parti unique au pouvoir, ou un chef suprême»[427]. Parallèlement au renforcement du régime totalitaire en URSS et à la formation de la dictature stalinienne, la critique de Mathiez se faisait entendre au fur et à mesure plus fortement. Au début des années trente, il prit une part active aux protestations de ses collègues français contre les processus politiques qui ébranlaient la réalité soviétique.
D’après le témoignage de Robert Schnerb, son ma’tre «aimait la discussion, le combat»[428]. Il est donc naturel qu’il n’ait pas omis de saisir l’occasion propice pour s’engager dans un combat acharné avec ses confrnres soviétiques pour la défense, en premier lieu, des intérêts de la science historique. Les historiens soviétiques furent plus qu’irrités de l’adhésion de Mathiez, au mois de janvier 1931, à la protestation des intellectuels français contre l’exécution des quarante-huit intellectuels soviétiques et surtout à celle des historiens français à propos des persécutions dont Tarlé fit l’objet en 1930 dans le cadre de l’«affaire académicienne». En novembre 1930, Mathiez signa avec Sylvain Lévi, Georges Pagns, Camille Bloch, Ramond Guyot, Phillipe Sagnac, Henri Hauser, Louis Eisenmann, Pierre Renouven, Charles Seignobos, Pierre Caron, Georges Bourgin, Robert Anchel, Henri Patry et Henri Sée une pétition en défense de Tarlé, qu’on avait arrêté au mois de janvier 1930 (il fut exilé à Alma Ata en septembre 1931 et ne revint à Leningrad qu’à la fin de 1932)[429]. Rappelons en outre que ces éminents historiens français ont été qualifiés par Loukine, à cause de leur intervention, de «professeurs les plus ré actionnaires de la Sorbonne [sic]»[430].
Publiant ce document en 1931 dans les