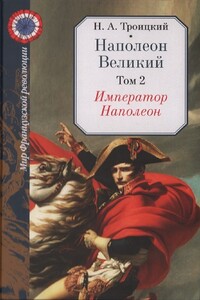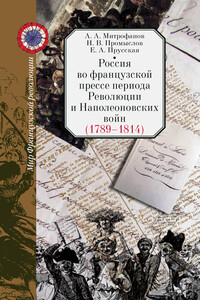Историки Французской революции | страница 65
Comme Tarlé estimait beaucoup non seulement Mathiez, mais aussi Aulard[407], «figure centrale de toute l’historiographie de la Grande révolution»[408], il avait entrepris en 1924 des démarches pour les réconcilier[409]; et il lui semblait qu’il y avait réussi, mais, hélas, il se trompait. Ce fut aprns la fondation au mois de mars 1924 de la Société des relations amicales franco-russes, appelée à partir du 10 juin 1924 Société d’une nouvelle amitié franco-russe[410], qu’on a unanimement élu Tarlé membre de la Société de
l’histoire de la Révolution Française[411], puis, en 1926, membre de la Société d’histoire de la Grande Guerre. Il a été le premier historien soviétique à qui on fit un tel honneur [412]. D’ailleurs, Tarlécontribua à l’élection à l’Académie des Sciences de l’URSS comme membres correspondants d’Aulard (1924), de Mathiez (1928) et de Camille Bloch (1929)[413].
Quant aux relations amicales établies entre Mathiez et les historiens soviétiques marxistes, il faut mentionner qu’elles avaient été conditionnées tout d’abord par les spécificités de ses intérêts scientifiques. Tout le monde savait qu’il était l’un des premiers historiens de la Révolution française à s’occuper de l’étude des problèmes d’histoire socio-économique de l’époque révolutionnaire; et c’est ce qui se trouvait au centre des intérêts de ceux qui avaient adopté la méthodologie marxiste. Il était en fait le premier chercheur français à avoir entrepris l’étude de la Révolution française «d’en bas»[414], et Jacques Godechot avait raison de le placer «au premier rang» des historiens de la Révolution qui avaient subi l’influence de Jean Jaurès[415]. Cependant, sa contribution à ce domaine fut finalement assez limitée[416]. En dépit de cette circonstance, ses divergences idéologiques avec Aulard, motivées principalement par leurs approches différentes à l’égard de l’époque révolutionnaire, le contraignirent à rompre ses relations avec son ma’tre en 1907–1908