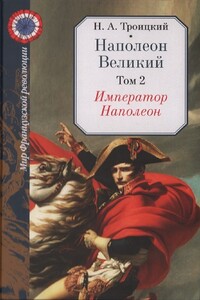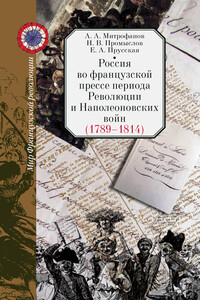Историки Французской революции | страница 63
Quant au profond respect de Mathiez envers Kareiev, qu’il caractérisait d’un «doyen des historiens russes […] qui a consacré sa longue et belle vie à l’étude de notre XVIII>e siècle et notre Révolution»[393], on peut en juger d’après la lettre de Gustave Laurent, directeur des Annales historiques de la Révolution française, adressée à l’historien russe le 14 septembre 1926: «Mon co-directeur et ami M[onsieur] Albert Mathiez, me demande de bien vouloir insister auprès de vous qui appartenez, d’ailleurs, au Comité directeur de notre revue, pour vous prier de bien vouloir renouveler vos abonnements de 1925 et 1926 que nous n’avons pas reçus et dont vous trouverez, sous ce pli, la facture […] Aussitôt votre réponse et dns que nous serons certain que l’envoi de nos fascicules vous arrive régulièrement, nous vous expédierons tous ceux qui vous manquent, avec le volume de la Correspondance de Robespierre que vient de para’tre et que nous offrons cette année, à nos fidèles abonnés»[394].
Aprns la révolution de 1917 Mathiez a été l’initiateur d’une très fructueuse coopération avec les historiens marxistes soviétiques, comme Nikola «Loukine, Grigori Friedland et d’autres, dont il avait fat h connaissance personnelle dans les années vingt lors des missions scientifiques de ces derniers en France. Certes, il avait le grand mérite de continuer les bonnes traditions des acquis de la science historique en Russie dans le domaine des études révolutionnaires. Mais, dans ce cas, il s’agissait principalement de la science historique marxiste, et il a atteint des résultats évidents et indéniables en invitant Kareiev, Loukine et d’autres à collaborer aux Annales historiques de la Révolution française, en dépit de leurs différentes orientations scientifiques[395]. Il ne ménaga pas non plus ses efforts personnels, malgré des possibilités plus que limitées (il ne savait pas le russe), en tâchant de présenter lui-même dans sa revue les études de ses collègues marxistes[396].
Les historiens soviétiques, à leur tour, ont été intéressés à améliorer leurs relations avec leurs collègues français, surtout avec ceux de gauche, dont Mathiez était le représentant le plus éminent. Du côté soviétique, les mérites de Tarlé sont évidents dans l’approfondissement des relations amicales entre les historiens des deux pays. Sa correspondance de cette époque prouve l’attitude aimable des historiens français à son égard et celui des autres historiens soviétiques. Dans son compte rendu sur l’une de ses missions scientifiques en France, il écrivait le 4 décembre 1924: