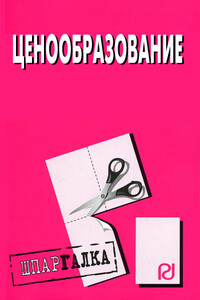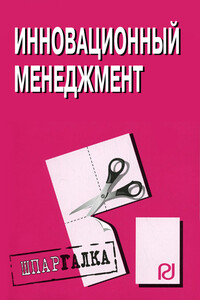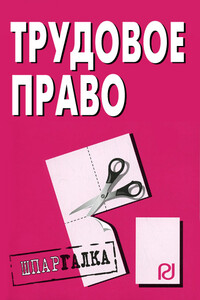Dictionnaire amoureux de la France | страница 12
Au fond, on ne sait pas par quel bout de sa lorgnette un citoyen lambda envisage le fragment d’histoire de France qui tombe sous son regard, et le somme de prendre un parti. Surtout quand ça chauffe. Ne jamais juger l’enrôlé d’une cause. Un milicien âgé de vingt ans fusillé à la Libération aurait pu tourner au héros de la Résistance, il eût suffi que son copain de chambrée lui prête un livre de Malraux plutôt que de Drieu ou de Rebatet. Je suis incapable d’imaginer mon choix au moment de la Fronde. Mazarin, les Princes ? Les Mousquetaires se sont divisés, j’aurais sûrement hésité. Toute cause semble attrayante à un cœur juvénile, aucune n’est claire si l’on prend le moindre recul. Mais justement, avec le recul de deux siècles, ce Corse ivre de fatuité et d’une vulgarité de parvenu continue de m’ébahir. Je ne suis pas le seul. Dans les cryptes de son inconscient, la France reste captive d’une mythologie délirante et magnifique : la sienne, depuis le pont d’Arcole jusqu’à la chambre de Longwood, à Sainte-Hélène. La vie de chacun des vingt-quatre maréchaux débute en chanson de geste et s’achève en roman de Balzac. Tous héroïques au feu. Tous vendus ou sous-loués à la Restauration puis à la monarchie de Juillet, nonobstant un passé plus ou moins gauchiste. Je les admire tous, même si j’ai des préférences pour ceux du Sud-Ouest (Bessières de Prayssac, Lannes de Lectoure, Murat de Labastide). Je ne pardonnerai jamais à Louis XVIII d’avoir fait fusiller Ney, même s’il a tourné puis retourné sa veste.
Napoléon I>er, c’est le grand soleil noir de notre mélancolie nationale. Ce qu’on lui doit est insondable, il nous le fait payer cher, en monnaie de spleen. D’une certaine façon l’histoire de notre conscience nationale débute à Waterloo, morne plaine. Ou dans le claque doré de l’Élysée à l’instant de l’abdication. À peine les Anglais l’ont-ils déporté, les vagues de la nostalgie inondent les cœurs des demi-soldes. Ils ont une jambe de bois, un moignon dans la manche et à peine de quoi s’offrir une prise de tabac, mais ils étaient à Essling avec Lannes (mon préféré), au siège de Lisbonne avec Soult, au passage de la Berezina avec Ney. Ils ont la faveur de la jeunesse, elle se morfond sous le prosaïsme du gros Louis XVIII, le puritanisme du sinistre Charles X, les atermoiements de l’insipide Louis-Philippe. « Je suis venu trop tard… » Ainsi va éclore le romantisme français, dans le sillage de Chateaubriand, l’autre géant, l’ennemi intime, très intime, du satrape qui toujours mendia son ralliement. Hugo, Balzac, Dumas, Vigny, Gautier, Musset, Stendhal : autant d’orphelins de l’épopée. « Mon père, ce héros au sourire si doux. » Ce père, nous n’avons pas cessé d’en porter le deuil, son absence a fait éclore Maurice de Guérin, Baudelaire, peut-être Rimbaud, Malraux assurément.