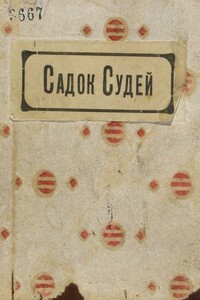Том 3. Публицистические произведения | страница 37
Eh bien, qu’est-ce à dire? que la question romaine posée dans ces termes est tout bonnement un labyrinthe sans issue; que l’institution papale par le développement d’un vice caché en est arrivée après une durée de quelques siècles à cette période de l’existence où la vie, comme on l’a dit, ne se faisait plus sentir que par une difficulté d’être? Que Rome qui a fait l’Occident à son image se trouve comme lui acculée à une impossibilité? Nous ne disons pas le contraire…
Et c’est ici qu’éclate visible comme le soleil cette logique providentielle qui régit comme une loi intérieure les événements de ce monde.
Huit siècles seront bientôt révolus depuis le jour où Rome a brisé le dernier lien qui la rattachait à la tradition orthodoxe de l’Eglise universelle. — Ce jour-là Rome en se faisant une destinée à part a décidé pour des siècles de celle de l’Occident.
On connaît généralement les différences dogmatiques qui séparent Rome de l’Eglise orthodoxe. Au point de vue de la raison humaine cette différence, tout en motivant la séparation, n’explique pas suffisamment l’abîme qui c’est creusé non pas entre les deux Eglises — puisque l’Eglise est Une et Universelle — mais entre les deux mondes, les deux humanités pour ainsi dire qui ont suivi ces deux drapeaux différents.
Elle n’explique pas suffisamment comment ce qui a dévié alors, a dû de toute nécessité aboutir au terme où nous le voyons arriver aujourd’hui.
Jésus-Christ avait dit: «Mon Royaume n’est pas de ce monde»; — eh bien, il s’agit de comprendre comment Rome, après s’être séparée de l’Unité, s’est crue en droit, dans un intérêt qu’elle a identifié avec l’intérêt même du christianisme, d’organiser un Royaume du Christ comme un royaume du monde.
Il est très difficile, nous le savons bien, dans les idées de l’Occident de donner à cette parole sa signification légitime; on sera toujours tenter de l’expliquer, non pas dans le sens orthodoxe, mais dans un sens protestant. Or, il y a entre ces deux sens la distance, qui sépare ce qui est divin de ce qui est humain. Mais pour être séparée par cette incommensurable distance, la doctrine orthodoxe, il faut le reconnaître, n’est guère plus rapprochée de celle de Rome — et voici pourquoi:
Rome, il est vrai, n’a pas fait comme le Protestantisme, elle n’a point supprimé le centre chrétien qui est l’Eglise, au profit du moi humain — mais elle l’a absorbé dans le moi romain. — Elle n’a point nié la tradition, elle s’est contentée de la confisquer à son profit. Mais usurper sur ce qui est divin n’est-ce pas aussi le nier?.. Et voilà ce qui établit cette redoutable, mais incontestable solidarité qui rattache à travers les temps l’origine du Protestantisme aux usurpations de Rome. Car l’usurpation a cela de particulier que non-seulement elle suscite la révolte, mais crée encore à son profit une apparence de droit.